

Leon Conrad, sp�cialiste de la broderie du XVII�me si�cle, viendra � nouveau � Notre Atelier le 12 mai. En attendant, il a accept� de r�pondre � quelques questions :
- Comment es-tu venu dans le milieu de la broderie ?
J�ai �t� initi� � la broderie par deux femmes :
en premier lieu, ma m�re, ancienne �tudiante en art, qui �tait une peintre de
talent et qui dessinait des jouets en feutrine rehauss�s de broderie. Nombreux
mod�les parurent dans des revues britanniques telles que Woman�s Own et Woman�s.
La deuxi�me femme �tait ma grand-m�re qui malgr� un dos un peu bossu �tait la
femme la plus �l�gante de la ville ! Elle accordait une tr�s grande
importance � son apparence et tous ses v�tements �taient faits sur mesure. Il y
avait donc toujours des morceaux de tissus et de fils partout dans la maison
que je pouvais utiliser pour jouer et r�aliser des choses.
Enfant, j�ai donc grandi dans un environnement artistique et cr�atif dans lequel le
textile et le travail des fils faisaient int�gralement partie chaque jour qui
passait. Ce n��tait d�ailleurs que l�un des domaines de cr�ation que j�ai
explor� avec le mod�lisme, la sculpture en terre, la cuisine, le dessin, la
calligraphie ou encore la r�alisation de posters�.tout cela �tant ensuite mis
de c�t� � l�adolescence.
La broderie n�est r�ellement revenue dans ma vie qu�� l�Universit� quand je
fus atteint de rub�ole. Un simple kit de broderie Bargello m�a accompagn�
pendant ma convalescence et � partir de ce moment l� j��tais � hooked �. Six coussins en canevas plus tard, je me
suis rendu compte que j�en avais assez de r�aliser des mod�les dessin�s par
d�autres et je d�cidais d�explorer d�autres points plus int�ressants, d�autres
techniques et diff�rents effets. En 1998, j�ai confi� mes premiers mod�les �
une coll�gue am�ricaine, Linn Skinner, qui a eu un
r�le pr�pond�rant dans le d�veloppement de mon int�r�t pour les techniques
historiques de broderie. A la fin de la premi�re ann�e, le hobby
s�autofinan�ait et en 2000, je cr�ais ma propre marque. Ceci m�a permis de me
plonger dans mes recherches historiques autour de la broderie en m�inscrivant
en 2003 � un Master of Arts en Histoire du Design, 3�me cycle
universitaire co-organis� par le Victoria and Albert Museum
de Londres et le Royal College of Art.
- Peut-�tre est-ce une question tr�s fran�aise, vu qu�en
France le milieu de la broderie est tr�s f�minin. Est-ce la m�me
chose en Grande-Bretagne ?
L�opinion pr�con�ue sur la f�minit� g�n�ralement associ�e � la broderie ne refl�te pas
vraiment sa pratique historique et contemporaine et je me r�jouis de personnifier
un d�fi � cette pens�e st�r�otyp�e !
La broderie a toujours �t� pratiqu�e par des hommes et des femmes, mais cette
vision a ensuite chang� de par la propre structure de la soci�t�. Dans
l�Angleterre m�di�vale, les brodeurs travaillaient en corporation tandis que
les femmes elles brodaient chez elles ou dans les couvents. Au 16�me
si�cle, les brodeurs royaux �taient des hommes et plusieurs ouvrages de l�un
d�entre ont surv�cu et sont expos�s dans plusieurs mus�es du Royaume Uni. Au 17�me,
plusieurs femmes s�int�gr�rent dans le m�tier traditionnel des brodeurs en tant
que brodeuses et dentelli�res de telle fa�on qu�en 1696, un groupe de femmes
brodeuses ont envoy� une p�tition au Parlement pour arr�ter l�importation de
l��tranger de broderies et de dentelles en expliquant qu�autrement plusieurs
milliers de femmes britanniques risquaient de perdre leur moyen de
subsister ! La tendance fut donc renvers�e et aucun retour en arri�re
n��tait possible. A partir de cette �poque l�, la r�alisation de v�tements est
devenu un industrie masculine et la broderie majoritairement f�minine. Ce qui
bien �videmment ne veut pas dire qu�il n�y avait pas de personnes des deux
sexes dans les deux m�tiers.
Les t�moignages laiss�s de nombreuses broderies navales, r�alis�es par des marins
montrent que dans une �poque o� la broderie avait prix un r�le de d�coration
dans la soci�t�, elle repr�sentait quand m�me un loisir pour les hommes et les
femmes.
A l �heure actuelle, il existe en Angleterre un groupe de brodeurs hommes
extr�mement talentueux. Ce qu�ils n�ont pas en quantit�, ils l�ont certainement
en qualit� ! Jack Robinson, avec qui j�ai eu le privil�ge d��tudier, est
un brodeur de blackwork �m�rite dont les r�alisations
se retrouvent dans des mus�es et des galeries priv�es dans le monde entier. Quin Davies, premier apprenti
homme de la Royal School of Needlework
est �galement quelqu�un que j�appr�cie et dont les broderies en trois
dimensions sont v�ritablement des chefs d��uvre. Richard McVetis,
qui a r�cemment remport� une bourse de la Embroiderers�
Guild, est un brodeur � suivre dont la sp�cialit� est
de r�aliser de tous petits ouvrages ressemblant � des petits cailloux
essentiellement r�alis�s avec des minuscules points de broderies ressemblant �
des graines. Il y a bien s�r d�autres artistes textiles et brodeurs de par le
monde mais ceux l� m�interpellent plus s�rement car ils font �cho � mon propre
int�r�t pour les techniques ancestrales de broderie, chacun d�entre nous
travaillant de mani�re sp�cifique, amenant cet art vers le contemporain que ce
soit en terme de design, technique ou les deux.

- En France, la broderie est plus un hobby qu�un m�tier,
m�me si nous avons Lesage qui est une grande exception. Est-ce que c�est
le cas en Grande-Bretagne ?
La broderie a toujours �t� utilis�e dans la haute couture mais la structure
sociale en Angleterre a permis la conservation de cet h�ritage hors du monde de
la mode et des mus�es. La Royal School of Needlework promeut activement les techniques
traditionnelles de broderie, forme des apprentis et propose des sessions
courtes de formation ouvertes � tous. Ils ont un service de r�alisation qui
travaille sur commande et qui est responsable de la production par exemple des
V�tements de Couronnements faits sur mesure pour chaque monarque et recouverts
de broderie d�or extr�mement travaill�e. Il y a plusieurs autres ateliers
professionnels sp�cialis�s dans certains types d��v�nements ou de march�s comme
les hauts dignitaires de justice ou encore les francs-ma�ons. Des individuels comme
Paddy Killer et Janet Haigh sont �galement tr�s
reconnus en tant d�artistes textiles en tant que tels.
- Tu as quand m�me fait des �tudes tr�s pouss�es en
broderie. Pourquoi cet int�r�t pour le XVI�me
si�cle ?
C�est une tr�s bonne question�difficile � r�pondre dans un petit paragraphe !
J�aurais besoin d�au moins 3 heures pour faire le tour de la question. Avant
tout, mon int�r�t pour la broderie anglaise se prolonge sur le 17�me
en plus du 16�me si�cle. En r�sum�, durant cette p�riode, les
brodeurs avaient une palette relativement r�duite de fils, teints en couleurs
naturelles dans des coloris rouges, bleus, verts, quelques jaunes et marrons,
blancs et noirs. Ils utilisaient traditionnellement des fils de soie sur du
satin de soie, du canevas ou du lin ; des fils m�tallis�s sur des velours
de soie ou d�autres riches �toffes le plus commun �tant sur du lin ou du satin
de soie.� Avec ce choix limit� en
couleurs et mati�res, les brodeurs ont r�ussi � obtenir une quantit� non
surpass�e de techniques, d�innovations, d�originalit�s, de fantaisies, de
diversit� que je ne saurais s�rement capable d�appr�hender ou comprendre
l��tendue des possibilit�s qu�ils ont concr�tis�s m�me si je passais le reste
de ma vie � les �tudier. Comme l�ont montr� mes recherches r�centes sur les
couvertures de livres en tissu et brod�s, la broderie de cette �poque �tait
souvent politique, religieuse ou charg� de trucs personnels et �tait utilis�e
comme un exutoire pour des croyances personnels difficilement exprimables
oralement les opinions des catholiques dans la culture protestante de
l�Angleterre du 17�me si�cle. Ce n�est pas seulement la technique de
broderie qui m�int�resse mais �galement toutes les histoires sous-jacentes �
ces broderies ; les raisons qui font qu�elles ont �t� r�alis�es. Ceci
explique ainsi que mes centres d�int�r�ts vont depuis la broderie m�di�vale et
la p�riode d�opus anglicanum jusqu�aux broderies des
Mouvements Arts and Crafts ainsi que les ouvrages
contemporains de grande qualit�.
- Peut-on vivre de la broderie ?
Je brode sur commande, je donne des cours, je fait des conf�rences et j��cris. Je
fais une combinaison de ces activit�s avec du travail en free-lance dans le
milieu de la musique et des grandes entreprises, tout en effectuant quelques
prestations en po�sie. En ao�t 2006, j�ai particip� en tant que po�te en
r�sidence au Premier Festival Culinaire d�Edinburgh et j�esp�re renouveler cette exp�rience en
2007 avec un spectacle po�tique. Comme tous les artistes, je me retrouve
actuellement dans mes meilleurs moments, avec une bonne vue (je croise les
doigts pour que cela continue) et la capacit� � me concentrer pendant de longs
moments : j�obtiendrais s�rement une reconnaissance plus importante quand
ces capacit�s seront relay�es par d�autres que je dois encore d�couvrir.
En th�orie, une personne pourrait vivre de la broderie mais ce n�est pas du tout
mon choix. Nombreux dipl�m�s de la Royal School ont
des carri�res en tant que designers, professeurs ou sp�cialistes. D�autres ont
poursuivis leur carri�re en tant qu�artistes. Je ne conseillerais pas cette
industrie (si on peut l�appeler comme cela) � une personne qui ne chercherait
qu�� faire de l�argent avec.
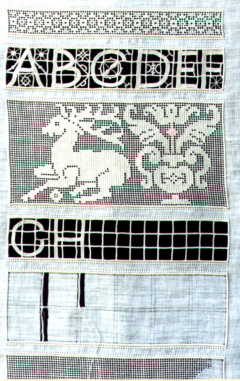
- Quels sont tes projets pour 2007 ?
Je travaille actuellement sur une collection de mod�les avec du � picot de
soie �, un type de fil tr�s fr�quemment utilis� au 17�me mais
plus fabriqu� � l�heure actuelle. J�ai pass� �norm�ment de temps � rechercher
les fournitures et les artisans qui pouvaient faire revivre ce processus de
fabrication et j�ai fait un r�el investissement financier � confectionner des
�chantillons. Il s�agit d�un long processus mais je crois que le r�sultat en
vaudra la peine.
J��cris aussi un livre sur les techniques de broderie d�une p�riode bien sp�cifique en
Angleterre. Il s�adresse particuli�rement � ceux qui ont un penchant pour
l�histoire de la soci�t�, qui travaillent dans l�industrie de l�h�ritage et du
t�moignage ou encore qui sont impliqu�s d�une mani�re ou d�une autre dans les
activit�s de loisirs. L�objectif est de donner un aper�u d�taill� et pr�cis des
techniques, outils, fournitures, motifs et points utilis�s dans la broderie
m�di�vale, renaissance, Elisab�thaine et Stuart.
Parall�lement � un agenda plein de cours et de conf�rences que j�aime beaucoup effectuer, je
suis en train de terminer le catalogue des livres � couvertures brod�es pour le
compte de la National Art Library du Victoria and
Albert Museum. Il y a encore quelques articles sur le sujet qui devraient voir
le jour et ma recherche sur les histoires autour de � Shepheard
Buss �, une pi�ce �nigmatique en blackwork du V&A Museum se
poursuit.� Ces projets m�am�neront sans
aucun doute au del� de 2007 mais il s�agit dans tous les cas des sujets qui
m�occupent en terme de broderie.
